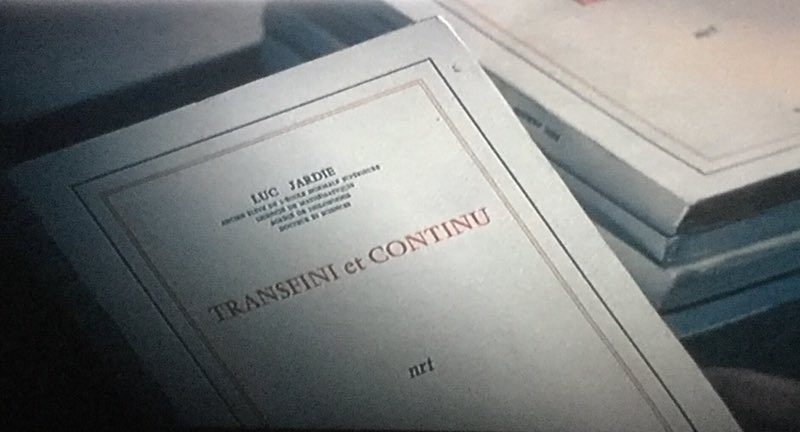Le titre et la charge, réflexions sur la noblesse en république
« L’aristocratie a trois âges successifs : l’âge des supériorités, l’âge des privilèges, l’âge des vanités ; sortie du premier, elle dégénère dans le second et s’éteint dans le dernier. »
Ainsi Chateaubriand proposait-il comme logique l’une des causes déterminantes du bouleversement révolutionnaire : la décadence de la noblesse française.
Depuis la fin du règne de Louis XIV, en effet, la haute noblesse aristocratique s’était engagée dans un processus de dégénérescence au terme duquel, à la veille de 1789, elle était considérée par le peuple comme viciée. En particulier, pour une partie de la bourgeoisie, elle ne présentait plus les qualités justifiant le monopole des affaires de l’État. Autrement dit et pour annoncer une distinction qui sera reprise par ailleurs, la couche supérieure du tiers État en fut à se convaincre que les aristoi – les meilleurs – ne résidaient plus essentiellement dans la noblesse.
Cette décadence, qui fut dans un premier temps une réaction presque logique à la mainmise louis-quatorzienne, avait eu pour matrice fondamentale l’extraordinairement longue période de paix qui courut durant la Régence. Cette exceptionnelle inactivité martiale – concrètement la vacuité de la mission première de la noblesse, couplée au désir de relâchement longtemps réfréné de la génération prenant les rênes de la Cour, eu pour effet direct d’instituer une décompression dans l’administration de la chose royale. Les charges s’allégèrent puis se financiarisèrent ; de proche en proche, le sens du service s’étiola. Cette mécanique sociale contribua à former une élite qui, pour une part croissante et de plus en plus à raison, fut marquée par l’indolence, bientôt la jouissance, enfin l’incompétence. Ainsi, de revers en scandales, la haute noblesse transmît ses tares tout au long du siècle pour que son image devienne incontestablement dégradée sous Louis XVI.
Rétrospectivement, si l’on se figure Giscard en duc d’Orléans et Mitterrand en cardinal de Fleury, la tentation est grande de filer la comparaison depuis la fin du règne gaullien. La tentation est grande, mais est-elle infondée ? Qui peut nier que l’élite française, depuis cinquante ans, s’est éloignée au moins moralement de son peuple, qu’elle s’est démarquée par ses idées et actions contraires à sa promotion et sa défense ; qu’elle est vue comme oisive, s’abandonnant à la facilité et renonçant à l’exemplarité ?
Introduction à l’ochlocratie
La dynamique suggérée par Chateaubriand n’est certainement pas née de son pur génie – bien qu’il eût adoré le faire croire. Il est probable que, lecteur des temps anciens et du sien, il ait reformulé, sinon précisé, l’anacyclose de Polybe. Selon cette théorie à la mode sous les Lumières, les régimes politiques sont voués à se succéder naturellement : à la monarchie succède la tyrannie, puis à celle-ci l’aristocratie, ensuite l’oligarchie, enfin la démocratie qui, elle-même dégénérant en ochlocratie, suscite la révolution et le retour à la monarchie[1].
Par sa proposition, notre ami malouin paraît voir en 89 le crépuscule de l’âge des vanités. Mais si l’on poursuite cette superposition, 93 s’apparenterait à l’ochlocratie et Brumaire en retour à l’ordre (au désespoir du cher François-René qui, aveuglé par un avenir mélancolique, ne sut voir en Napoléon le roi qu’il attendait[2]). C’est sur cette étape de l’ochlocratie – le pouvoir de la foule – que nous devons nous arrêter. Moins cernée que les autres, elle constitue pourtant pour Polybe et les polybiens la pire de toutes : c’est l’ère du chaos enfanté par l’abandon de la raison et les manipulations de la foule spoliée. C’est la privatisation de la volonté générale.
Le problème est que, de ce trou d’air ochlocratique, nous en sentons en France les premières secousses. Mais le fatalisme étant renonciation, il incombe de nous en préserver ; ainsi conserver les vertus de la démocratie et éviter la révolution qui ne peut qu’être brutale, par-là non-désirable. Chateaubriand tisse le lien entre la décadence de l’élite et la ruine d’un peuple : pour éviter le naufrage, tout commence donc par comprendre pourquoi nos capitaines ne « capitainent » plus ; pourquoi notre élite n’en est plus une.
L’incapacité formelle ou la dilution de la décision
L’on proposera un développement autour de l’idée suivante : notre élite (considérée au sens large : politique, administrative, économique, culturelle, etc.) faillit car elle n’a plus la capacité de l’être – par sa faute ou non, peu importe. Cette incapacité s’exprime à deux niveaux complémentaires, dont on propose un qualificatif empreint de commodité : l’incapacité formelle et l’incapacité matérielle. Chacune d’elle se rapporte à l’élément central de la politique : la décision.
L’incapacité formelle désigne ici le fait que notre élite ne dispose plus du pouvoir de décider. Non pas qu’elle ne déciderait de rien, naturellement, mais la capacité décisionnelle est diluée dans une telle proportion qu’elle en a perdu sa gravité. Le souci ne se révèle pas dans l’état de cette dilution mais dans ses conséquences, car décider implique d’être responsable. Or, la répartition dans la multitude du pouvoir décisionnel ne permet pas d’en désigner un titulaire et autorise chacun à attendre d’un autre qu’il agisse. Et pire que d’instituer la léthargie, cette dilution féconde la cécité de l’impunité car, si personne n’est responsable, il n’y a plus de faute et tout va bien.
Il a été préféré ne pas détailler outre mesure cette incapacité formelle dans ses causes (institutions politiques, sciences de la direction, etc.) et ses remèdes (libre à chacun d’en avancer) en ce qu’elles appellent des sujets qui sont hors du nôtre. Mais se convaincre de sa réalité est aisé tant les exemples irradient notre contemporain. Dans la sphère politique, du gouvernement devant s’accommoder des exigences européennes jusqu’au maire forcé de concilier avec foule de collectivités en passant par le Parlement sommé de « bruxelliser » la loi ; dans la sphère civile, des administrations et institutions où l’on ne trouve jamais réellement quelqu’un en mesure de résoudre un problème jusqu’au monde des affaires où la responsabilité pénale des sociétés fait office de couverture ; de tous, nul n’est absolument[3] libre et peut toujours se défausser sur un tiers.
L’incapacité matérielle : le titre et la charge
Procédant de l’incapacité formelle par la facilité corruptrice qu’elle induit mais la nourrissant tout autant, l’incapacité matérielle correspond quant à elle à l’idée selon laquelle notre élite n’est plus à même de prendre les bonnes décisions. C’est ici que nous devons raviver nos instructions sur l’aristocratie car c’est elle qui est notre porte-flambeau ; or le feu éclaire comme il ravage. Notre élite actuelle souffre de maux analogues à la noblesse du XVIIIe siècle : baignée dans le confort, elle a perdu conscience de la portée de ses actes et de l’engagement de sa parole, et lorsque le monde lui rappelle qu’il est réel, elle bafouille et bafoue.
Si l’on acte qu’elle est moribonde, comment la revigorer, voire la régénérer ? Pour ce faire, plaçons la réflexion sur les deux attributs de la noblesse d’Ancien Régime lorsqu’elle méritait encore ce nom : le titre et la charge. Le titre, c’est le justificatif conditionnel pour exercer une mission ; la charge, c’est la mission. C’est donc cette dernière qu’il convient d’étudier en premier. Pour ce qui nous concerne, circonscrire la charge, c’est borner ce qu’on attend de ceux qui sont, de près ou de loin, responsables de la vie nationale.
Comme patron, et si, comme Péguy, l’on est convaincu de la République qu’elle est notre royaume de France, nous conseillons de graver dans les âmes le précepte adressé par Bossuet à Louis XIV :
« Les bons rois sont les vrais pères des peuples ; ils les aiment naturellement : leur gloire et leur intérêt le plus essentiel est de les conserver et de leur bien faire, et les autres n’iront jamais en cela si avant qu’eux. »
Brève théorie heureuse de l’État
Ainsi le but de l’État – son objet social oseraient certains – serait le bonheur de son peuple. Nous y souscrivons. Pour idéaliser son bonheur, il est fatal qu’un peuple détermine ses intérêts ; et pour cela, qu’il sache qui il est. C’est ici l’occasion, parenthèse nécessaire, de dépassionner deux notions sensibles dans le débat public français.
Le premier est la souveraineté, qui n’est, autant pour un individu que pour un corps politique, que la condition sine qua non à sa liberté. Toutefois comment déterminer ses intérêts, de bout en bout, comment aspirer au bonheur, si l’on n’est pas libre ? Le lecteur pourra, s’il le souhaite, lier dans le domaine politique cette problématique à celle de l’incapacité formelle.
De même, l’identité doit être politiquement désaxée, neutralisée : ça n’est que la réponse à la question de l’être ; qui suis-je, qui sommes-nous ? Et comme la liberté permise par la souveraineté, la caractérisation de l’être est indispensable à la projection de son bonheur. Qu’il est flagrant que la faillite de ses élites coïncide avec la crise identitaire individuelle et collective des Français ! Ô de combien la dépression de notre temps résulte du refus à nous demander qui nous sommes ! Il ne tient qu’à cet effort pour cesser d’errer sur les flots du dehors sans gouvernail du dedans. Nul ne voit loin devant s’il est aveugle à ce qui le précède, nul ne peut prétendre à la hauteur d’esprit sans profondeur de l’âme ; là est l’identité : au croisement de ces deux lignes, naturellement mouvant par la raison. Parenthèse close.
Le combat comme charge primaire
Dès lors, si le peuple est un ensemble de dénominateurs identitaires communs, l’État n’est là que pour les conserver et leur bien faire. Et si l’État est État pour que ses citoyens soient heureux, la charge des meilleurs d’entre eux est de combattre les entraves à cet idéal. Le terme de combat emprunte au genre militaire mais ne s’y réduit pas. Dans ces lignes le combat ne vise donc pas celui de la guerre mais celui de la paix ; mais tous deux sont liés car ils poursuivent le même objectif. De même que l’armée meurt pour la défense du peuple, le haut fonctionnaire, le magistrat, le directeur de publication, l’administrateur d’une société stratégique, etc. doivent œuvrer en quête de cet horizon commun et avec la France pour boussole.
Mais pour combattre, trois prérequis sont appelés : d’abord savoir qu’il le faut, ensuite en avoir envie, enfin être armé. De toute évidence, tout comme il apparaît que notre élite ne place pas le bonheur du peuple français au premier rang de ses désirs, il semble que cette trilogie soit aujourd’hui désuète.
Pour ce qui est de la première condition, tant de nos dirigeants ignorent ou sont pétrifiés par la tragédie qu’est le monde ; s’agissant de la seconde, pour beaucoup le bénéfice personnel a dévoré le dévouement ; quant à la troisième, elle peut restaurer ses devancières et fait l’objet des paragraphes suivants.
Pour une noblesse républicaine
Comme annoncé, il est nécessaire à ce stade d’insister sur la distinction entre noblesse, élite et aristocratie, qui ont jusque lors été usités selon une relative indifférence. Cette confusion n’était pas dommageable en ce que les propos relevaient d’une réflexion plutôt universelle ; elle le serait dès à présent car ce qui suit s’attache à la réalité de la République Française.
L’une des apories de la France contemporaine est que les trois notions ne se recoupent pas. Son élite (selon le Larousse, la minorité éminente) n’est, prise globalement, ni une aristocratie car, bien qu’elle en jouisse du pouvoir (politique, économique, médiatique), elle ne regroupe pas les meilleurs, ni une noblesse car, si elle en jouit du titre, elle n’en assume pas la charge (défendre le bonheur des Français). Heureusement, le génie français apporte une solution simple à cette équation dès le premier article de la Déclaration de 1789 :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. »
La vertu fondamentale de la République étant l’égalité des citoyens et leur seule distinction par le mérite, la parade à la décadence est trouvée : comme chaque Français peut être parmi les meilleurs, il est impérieux que l’élite soit aristocratique pour être armée et qu’on la désigne noblesse pour affecter à ses représentants la charge de combattre.
La culture pour première arme
Dès lors que l’attribution de ces fonctions décisives de la vie publique[4] est subordonnée à la présentation d’un titre, reste à savoir quelles sont les qualités requises pour l’obtention de ce dernier (et qui, par défaut de production dans l’exercice, en justifieraient le retrait). En d’autres termes, comment sélectionner les meilleurs ? Là encore nous suggérons de nous rapporter à Bossuet et aux sentences antiques qu’il enseigna au Dauphin, reprenant ici Cyrus à Cambyse[5] :
« Un homme né pour commander doit éviter, sur toutes choses, de ne pas savoir, c’est-à-dire d’être mal instruit. »
Une des explications indiscutables de l’effondrement du niveau de nos élites est la chute vertigineuse de leurs connaissances. Parce que la facilité de son monde et la dilution des responsabilités n’ont pas requis d’elle d’avoir une densité morale et intellectuelle supérieure, la classe dirigeante française a désavoué ce qui justifia longtemps son rang : la quête de l’esprit universel. Ce qui illustre cette déconsidération est le traitement de la culture générale pour l’accès aux grandes écoles ou hauts concours : soit elle n’est plus exigée, soit elle l’est mais enseignée comme une matière telle une autre. Cette situation révèle les dispositions attendues, de manière générale, pour l’accès aux formations supérieures, ainsi aux postes de direction : l’on souhaite pour gouverner soit d’excellents techniciens – qu’importe qu’ils ignorent l’au-delà de leur spécialité, soit des connaisseurs superficiels – qu’importe qu’ils soient incompétents en profondeur.
Or la technique est, à un certain degré, vaine si elle ne s’accompagne pas de références universelles. La philosophie, l’histoire, la littérature et l’art en général sont aujourd’hui dénigrés comme n’ayant pas d’utilité scolaire et sociale en tant que tels alors qu’ils assurent la profondeur de l’âme et la complétude de l’esprit nécessaires à la faculté de décision raisonnable et responsable. Non qu’il faille écarter la science technique ; au contraire elle est indispensable, mais renoncer à la science culturelle a facilité la perte de notre élite en la privant d’assise dans le monde et l’humanité. En effet, c’est pour immensément parce qu’elle connaîtra l’Histoire et les histoires, qu’elle aura lu et vu, c’est parce qu’elle saura comprendre et surprendre qu’une élite pourra combattre. C’est d’autant qu’elle acquerra la carrure et la colonne vertébrale nécessaires pour assumer leur charge.
Sauver la République par l’école
L’établissement d’une noblesse républicaine passe donc avant tout par le redressement de l’instruction et de la formation publique. Sans se lancer dans un programme détaillé de réforme systémique, l’on suggère deux idées centrales desquelles le reste pourrait découler.
D’une part, s’agissant de l’éducation nationale, il nous faut marteler que l’école est en République ce que le baptême est en religion : la véritable naissance. Car c’est elle qui assure la transmission de la compétence, elle est chargée d’élever les meilleurs indifféremment de leur origine là où le sang assumait auparavant cette sélection. Or en abaissant le niveau d’exigence de l’école publique, on sanctionne les enfants ne pouvant obtenir, par leur famille ou leurs moyens, la part symétriquement croissante de connaissances complémentaires réclamées par l’excellence. Ainsi l’on favorise la reproduction sociale, sous-représentant la compétence en haut de l’échelle sociale et la sous-exploitant en bas ; en somme violant la promesse de 1789 réitérée en 1944.
D’autre part s’agissant de l’enseignement supérieur et particulièrement de la formation à la charge publique, convainquons-nous de promouvoir une formation universitaire d’excellence gratuite prodiguant la meilleure science technique au détriment des superficiels IEP et écoles de commerce. Ce n’est que dans un second temps que la distribution du titre de noblesse doit s’effectuer : en sélectionnant parmi les meilleurs techniciens les mieux armés pour servir et assumer leurs actes.
Le lecteur l’aura compris, ce plaidoyer ne vise qu’à sauver la démocratie en restaurant les fondements de la République. Pour nous garantir la paix civile, la noblesse républicaine doit ainsi s’entendre comme une puissance conservatrice au service du peuple. Naturellement, la qualité de conservatrice ne doit pas se comprendre en son acception politique mais en ce qu’elle doit maintenir la nation dans la liberté de son état démocratique et la garder du chaos promis de l’ochlocratie. Et notre chance, en République, c’est que l’aristocratie puisse demeurer dans l’âge des supériorités.
Romain Petitjean
[1] Pour être plus précis que concis, l’on peut apporter à cette synthèse les deux extensions suivantes :
- l’image cyclique est simplificatrice ; en réalité serait plus appropriée celle d’une roue dentelée accentuant les corruptions des caractéristiques : la monarchie dégénère en tyrannie, l’aristocratie en oligarchie, la démocratie en ochlocratie ;
- la révolution telle qu’elle est entendue dans l’anacyclose n’est pas nécessairement à comprendre comme une révolution populaire, mais plutôt comme une reprise en main vigoureuse de type providentialiste.
[2]Bonaparte en révolutionnaire, la Révolution Française est tellement vaste que l’aventureux théoricien pourrait y voir une anacyclose dans l’anacyclose.
[3]Absolu doit ici être compris n’ayant pas de rivalité verticale, c’est-à-dire que la décision ne résulte pas d’un choix pleinement souverain, qu’il soit limité dans son éventail ou qu’il suppose une reddition de compte. Absolu doit donc être distingué de total, qui la faculté d’agir en toute matière – il n’y a pas de rivalité latérale. Par exemple, la monarchie absolue n’était pas totale, tandis que l’est un régime totalitaire.
[4]Il est laissé libre à chacun de se figurer le spectre de ce domaine réservé. En tout état de cause, Qu’aucune méprise ne soit faite, cette noblesse est fondamentalement distincte du corps élu : en aucun cas la condition du titre ne saurait grever une fonction élective. Cette dernière doit naturellement demeurer libre et la décision politique doit s’imposer. Seulement, il est supposé que, par environnement et émulation, les élus également se démarquent par leur supériorité.
[5] Le premier Cyrus II le Grand, fondateur de l’Empire Perse Achéménide au VIe siècle avant l’ère chrétienne, le second son fils et successeur.